Les Morphiniques
Historique
- 3000 avant jésus
christ en IRAK
- référence écrite
de l’utilisation du jus de pavot -300 avant jésus
christ
- VIII° siècle
:utilisation en Chine contre la dysenterie
- X et XIII siècles :
utilisation en Europe
- XV° : analgésique
- 1806 : mise en
évidence de la morphine (Morphée : dieu des songe)
- 1832 : Codéine
isolée
- 1848 : Papavérine
isolée
- 1853 : création de
la seringue
- 1960 : création des
molécules antagonistes
- 1973 : découverte
des récepteurs
- 1975 : découverte
des opioïdes endogènes
Mécanisme
d’action
Tous les morphiniques
agissent par des récepteurs spécifiques .
- Agoniste pur :
activité intrinsèque de 1
- Agoniste
partiel : activité intrinsèque entre 0 et 1
- Antagoniste
activité : intrinsèque nulle
Récepteurs
morphiniques :
La puissance d’action
du récepteur est conditionnée par :
- l’affinité aux
récepteurs
- l ‘activité
intrinsèque de la molécule
- l’affinité
conditionne également la demi vie de dissociation
Les différents
récepteurs :
| Récepteurs |
types |
actions |
| µ donnant µ1 µ donnant µ2
|
Morphine agoniste Morphine mais moins
affine
|
analgésie, sédation,
bradycardie dépression respiratoire,
dépendance physique, dysphorie
|
| § (delta) |
Enképhaline |
analgésie, dépression
respiratoire |
| K (Kappa) |
Nalbuphine (NUBAIN) |
analgésie, sédation et
dépression respiratoire |
| Sigma |
Kétamine (kétalar) |
dysphorie, delirium, HTA,
hallucinations, tachycardie, nausées |
On pense qu’il existe
des complexes de récepteurs.
Localisation :
Sur trois niveaux :
- Récepteurs
périphérique : au niveau des terminaisons libres
(nocicepteurs), lors de processus d’inflammation ,
ces récepteurs qui n’existent pas à l’état
basal vont apparaître. L’intérêt est pour nous
une utilisation locale de morphine dans les processus
inflammatoires localisés (exemple en intra-articulaire)
- Récepteurs
médullaires (Moelle épinière ) : au niveau des
couches superficielles dites 1 et 2 de la corne dorsale
- Récepteurs
cérébraux : Le cerveau au niveau notamment du
plancher du IV me ventricule et des noyaux gris centraux
AGONISTES PURS
: agonistes morphine
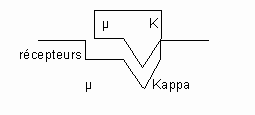 Les deux récepteurs sont activés.
Les deux récepteurs sont activés.
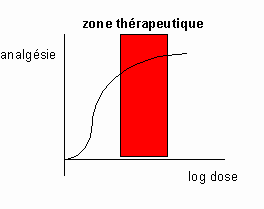 L’analgésie est illimitée
avec la hausse des doses. Agoniste pur : activités
intrinsèques de 1
L’analgésie est illimitée
avec la hausse des doses. Agoniste pur : activités
intrinsèques de 1
ANTAGONISTES
: Affinité compétitif de l’agoniste et l’antagoniste
sur le récepteur
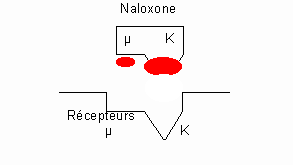 Pas d’activation des récepteurs
Pas d’activation des récepteurs
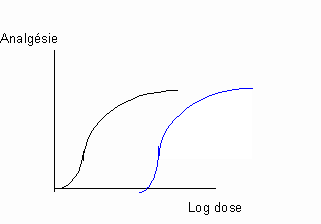 Déplacement de la courbe dose réponse
vers la droite grace à la présence de l’antagoniste qui
occupe les récepteurs sans activité intrinsèque.
Déplacement de la courbe dose réponse
vers la droite grace à la présence de l’antagoniste qui
occupe les récepteurs sans activité intrinsèque.
AGONISTES
PARTIELS : Buprénorphine (Temgésic (c) )
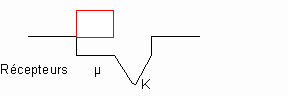 Activation partielle du récepteur µ.
Activation partielle du récepteur µ.
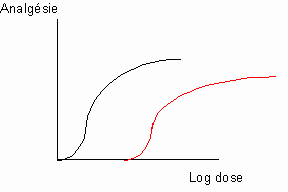 L’Agoniste partiel qui est aussi
antagoniste par son blocage du récepteur empêchant
l’agoniste pur de s’y fixer , l’agoniste partiel
déplace la courbe dose réponse vers la droite , d’autre
part , il est à noter l’existence d’un plateau
limitant l’activité maximale , de part la valeur faible
intrinsèque de son action pharmacocinétique et de son activité
antagoniste. (il ne sert à rien d’augmenter les doses).
L’Agoniste partiel qui est aussi
antagoniste par son blocage du récepteur empêchant
l’agoniste pur de s’y fixer , l’agoniste partiel
déplace la courbe dose réponse vers la droite , d’autre
part , il est à noter l’existence d’un plateau
limitant l’activité maximale , de part la valeur faible
intrinsèque de son action pharmacocinétique et de son activité
antagoniste. (il ne sert à rien d’augmenter les doses).
AGONISTES
ANTAGONISTES : Nalbuphine ou Nubain
n’active qu’un des deux sites empêche l’agoniste
pur déplaçant la courbe dose effet vers la droite (tout comme
l’agoniste partiel il y a un plateau d’effet )
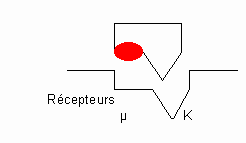 = antagonise µ - agoniste K.
Activation des récepteurs K, d’où activation partielle.
Occupation de µ : sans action.
= antagonise µ - agoniste K.
Activation des récepteurs K, d’où activation partielle.
Occupation de µ : sans action.
LIEU
D’ACTION DES MORPHINIQUES
- En périphérie sur
les terminaisons A Delta et C si et seulement si il y a
inflammation.
- L’action
principale spinale pré et post synaptique par
blocage de la transmission du message nocicèptif . Mais
le tact et la proprioception passent encore (effet
différentiel = pas d’altération des messages non
nociceptifs).
- L’action supra
spinale (cerveau) par blocage des contrôle inhibiteurs
diffus (ces contrôles inhibiteurs diffus ont pour rôle
de faire ressortir le message nocicéptif du bruit de
fond général noyé dans des messages autre que
douloureux .L’inhibition de ces contrôles
inhibiteurs diffus replonge le message nocicéptif dans
ce bruit de fond .
PROPRIETES
PHYSICO-CHIMIQUES
- Diffusion dans le
Système nerveux central
- La forme diffusible
est la Base (forme non ionisé) non lié aux protéines
(fraction libre)
- La caractère
liposoluble de la molécule conditionne son volume de
distribution
- morphiniques = bases
faibles
LA DIFFUSION :
- La diffusion est
passive et se fait suivant un gradient de concentration
- La diffusion est
d’autant plus rapide que la molécule est
liposoluble
- La morphine est la
moins liposoluble
- Plus le volume du
compartiment central d’une molécule est faible plus
la concentration initiale y est élevée.
- On définit un index
de diffusion en fonction du volume du compartiment
central
Classification suivant la
solubilité des produits :
Sufentanil (53.5) >
Fentanyl (20.4) > Alfentanil (100) > Pethidine >
Morphine (1.1) (la moins liposoluble)
Fenta et Sufenta sont les
plus liposolubes =>
se fixent sur les graisses.
CLASSIFICATION
| naturel |
Semi synthétique |
synthétique |
| Morphine |
Héroïne |
Piperidine ou Pethidine (Dolosal) |
| Codéine |
Eterphine |
Fentanyl |
| Papavérine |
|
Sufentanil |
| |
|
Alfentanil |
| |
|
Remifentanil |
MORPHINIQUES :
SONT ILS DES AGENTS D’ANESTHESIE A PART ENTIERE ?
Action des
morphiniques :
Les morphiniques à dose
forte peuvent entraîner une altération de la vigilance et une
perte de conscience . Seulement 1% des patients se rappellent de
la période per opératoire . Donc la conscience persiste .
L’association
morphinique Sufentanil et Halogénés :L’utilisation du
sufentanil permet de diminuer la MAC de l’halogéné en
question. Idem pour Thiopental et sufentanil , on constate une
diminution des doses de pentothal pour les mêmes effets.
Il existe toujours un
petit pourcentage de personnes conscientes -> nécessité
d’associer un agent hypnotique (un morphinique ne permet pas
toujours de faire une anesthésie toute seule).
EFFET
ANALGESIQUE DES MORPHINIQUES
La courbe dose réponse se
caractérise par :
- une analgésie
intense
- une analgésie
constante
- qui marche sur toutes
les douleurs
- est dose dépendante
Seule la puissance , le
délai d’action et la durée d’action de la molécule
influencent la qualité de l’analgésie.
Il existe une plafond
maximum pour les agonistes partielle-antagonistes.
EFFET
PHARMACODYNAMIQUE
- ACTION
RESPIRATOIRE :
Dépression de la réponse de l’organisme à
l’hypercapnie
NB : on fait inhaler du CO2 : normalement la
réponse de l’organisme est puissante, or avec du
sufentanil la réponse est déprimée, mais la
dépression est moindre et de plus courte durée
qu’avec du fentanyl.
- LA DEPRESSION
RESPIRATOIRE :
- Est
dose dépendante et apparaît dès la
plus faible dose
- Dépression
de la réponse des centres bulbaires à
l’hypoxie et l’hypercapnie
- dépression
des centres bulbaires impliqués dans la
régulation de la fréquence respiratoire
- L’APNEE
- L’apnée
apparaît au delà d’un certain
seuil
- L’apnée
est d’origine centrale par
dépression bulbaire
- L’apnée
peut être d’origine occlusive,
perte de la synchronisation entre muscle
inspiratoire et du larynx par blocage des
muscles laryngées ( souvent patient
obèse , apnée du sommeil rapportée en
post opératoire avec désaturation )
- TOUS
LES MORPHINIQUE EXERCENT LA MEME
DEPRESSION RESPIRATOIRE A DOSE
EQUIANALGESIQUE (analgésie et
dépression respiratoire sont
indissociable )
- Dépression
respiratoire et apnée sont
indissociables
- FACTEUR
INFLUENCANT LA DEPRESSION RESPIRATOIRE :
- L’âge :
la personne âgée est plus sensible
- la
douleur antagonise la dépression
respiratoire (qui est un phénomène
progressif débutant par la sédation
somnolence)
- LA RIGIDITE
THORACIQUE :
- Par
diminution de la compliance thoraco-pulmonaire ,
possibilité d’empêcher l’insufflation
- Mécanisme
d’action supra spinal qui peut être
prévenu par curarisation
- La rigidité
varie avec l’importance et la rapidité
d’injection de la dose pour un même
morphinique
- LA
BRONCHONSTRICTION :
- par
Histamino-libération surtout pour la Morphine et
le Dolosal
- entraîne une
dyspnée asthmatiforme
- NB : ce
qui peut être considéré comme bronchospasme
sous fentanyl n’est en fait qu’une
rigidité musculaire.
- LA DEPRESSION
DE LA TOUX :
- Dépression
du centre de la toux
- pas de
parallélisme avec la dépression respiratoire
- permet une
bonne tolérance de la sonde trachéale
- expose au
risque d’encombrement trachéo-bronchite
notamment en VS
- ACTION SUR LE
SYSTEME NERVEUX :
- Inhibition
du SNC :
- Analgésie
- Dépression
respiratoire
- Sédation
- Modification
de l’EEG (quasi sommeil)
- Excitation
du SNC :
- Myosis
- Nausée
- Vomissements
- ACTION
PSYCHOMOTRICE :
- Sédation des
morphiniques mais parfois, sur terrain
particulier, il peut y avoir une agitation
psychomotrice.
- ACTION
PSYCHOAFFECTIVE :
- Le plus
souvent euphorie (impression de bien-être) mais
possible dysphorie (impression générale de
malaise), angoisse , hallucination, surtout
Buprénorphine
- ACTION
HYPNOTHIQUE :
- Altération
de la vigilance
- Perte de
conscience intermittente
- ACTION SUR
l’EEG :
- Modification
ressemblant à celle induite par le sommeil
- Peu
d’effet sur le potentiel d’action
évoqué somesthésique qui sont pourtant utiles
lors de la vérification des lésions de la
moelle lors d’opération du rachis.
- ACTION
CARDIOVASCULAIRE :
- Pas ou peu
d’action vasculaire
- Bradycardie
sinusale (supprimé par atropine) par stimulation
du noyau X (vague)
- Les
histamino-libérateurs , Morphine et Dolosal
entraînent une vasodilatation artèriolaire et
veineuse dose dépendante avec une hypotension
qui peut être prévenue par des anti H1( Atarax,
Polaramine ) ou anti H2 (Tagamet , Raniplex....)
- Pas
d’effet sur contraction myocardique même à
forte dose sauf pour le Dolosal ...
- Attention
chez les sujets hypovolémiques ou la stimulation
sympathique est importante , l’équilibre
parasympathique - sympathique peut être
fragilisé en faveur du versant parasympathique
donc risque de collapsus
- ACTION
INTESTINALE :
- Relaxation du
sphincter oesophagien (donc considération
estomac plein si traitement chronique au
morphiniques)
- Retard de la
vidange gastrique
- Hausse du PH
gastrique
- Diminution de
la motilité intestinale et du transit
- ACTION SUR LE
TUBE DIGESTIF :
- Nausée
- Vomissement
- Fréquente
(20 à 60 % des cas)
- L’incidence
est la même quelque soit la voie
d’administration
- Les
morphiniques différent entre eux dans la
capacité d’induire les nausées à dose
équi analgésique
- Mécanisme
d’action : périphérique par retard de
la vidange gastrique et par effet central ,
prépondérant par stimulation de la trigger zone
au niveau de l’area prostrema )
- Toute
stimulation supplémentaire de cette zone
augmente les nausées vomissements (exemple
stimulation vestibulaire , l’A.G.
ambulatoire ...)
- Le niveau
élevé de la douleur renforce l’action
émétique des morphiniques
- Traitement
des nausée vomissements :
- Anticholinergique
(atropine)
- Primperan
mais action brève
- Neuroleptique
( 1 mg Droleptan Droperidol ,
Haloperidol)
- Les
Antagonistes de la Serotonine (ex
Zophréne )
- Le
Propofol (Diprivan à effet
antiémétisant 10 mg/h)
- ACTION
RENALE :
- Les
récepteurs aux opiacées participent au
contrôle hydro électrolytique
- Récepteurs
µ sont antidiurétiques
- Ils
possèdent une action sur l’ADH , la
morphine augmente l’ADH , donc diminue la
diurèse
- ACTION
URINAIRE :
- Diminution du
tonus des fibres longitudinales
- Hausse du
tonus des fibres circulaires
- Cat :
seul le traitement à la Naloxone reste efficace
face à la rétention urinaire mais la cessation
de l’analgésie reste gênante et le sondage
urinaire devient alors le moyen le plus simple
pour éviter ces désagréments.
- ACTION
PUPILLAIRE :
- Myosis par
stimulation du système nerveux central
- Irido
constriction
- NB le myosis
n’est pas un bon signe d’imprégnation
morphinique , le Myosis peut être inhibé par
l’atropine, les ganglioplégiques, la
Naloxone.
- ACTION
BILIAIRE :
- Hausse du
tonus du sphincter d’Oddi provoquant une
cholestase dose-dépendante pour tous les
morphiniques.
- Hausse des
sécrétions gastro-intestinales dont
l’importance clinique reste minime
- Les effets
peuvent être inversés par le Glucagon et la
Naloxone
- LE
PRURIT :
- Mécanisme
inconnu
- Rôle de la
Cholestase ?
- Signification
du tropisme nasal et de la Face ?
- Traitement :
la Naloxone
- THERMOREGULATION
ET FRISSONS :
- Action sur la
température corporelle
- Seul la
Pethidine (ou Dolosal) est le seul morphinique
efficace dans le traitement du frisson post
Anesthésique.
- NB : Au
réveil le frisson augmente la consommation en
oxygène , le débit cardiaque sera augmenté et
la consommation myocardique également .Donc
attention chez les coronariens .
- 25 mg de
Dolosal suffisent à prévenir le frisson post
anesthésique .
- TOLERANCE :
- Nécessité
d’augmenter les doses pour maintenir les
mêmes effets après quelques jours de traitement
/ Le mécanisme évoqué est la régulation des
récepteurs et le découplage récepteurs et
protéines G ainsi que la mise en jeu d’un
système compensateur qui s’oppose au
morphinique.
- DEPENDANCE
PHYSIQUE :
- Syndrome de
sevrage si arrêt du traitement ou si antagonisme
.
- Signes
Cliniques :
- Larmoiement
- Rhinorrhée
- Sueurs
- Tachycardies
- Crampes
abdominales
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhées
- Déshydratation
- Mydriase
- Torpeur
- Agressivité
- Hypotension
- Acidose
- Agitation
- DEPENDANCE
PSYCHIQUE :
- L’Assuétude :
état de compulsion pour bénéficier des effets
psychotropes.
- Rare
dépendance iatrogène .
LA
PHARMACOCINETIQUE
- Modèle à Trois
compartiments : Arrivée dans le secteur plasmatique
des morphiniques puis équilibre avec le Volume effecteur
VE (système nerveux) , puis redistribution vers VC V2 et
V3 ayant pour effet la diminution des concentrations dans
le VE avec cessation de l’effet .
- La durée de
l’effet ne dépend pas de l’élimination mais
de la redistribution.
- Ex L’Alfentanil
a un VD 6 fois plus faible , la concentration dans le VE
sera moins élevée , la phase d’élimination plus
précoce ...
NOTION
DE CONTEXTE SENSITIF HALF TIME ou demi vie
opérationnelle :
- Cela traduit le temps
de la décroissance des concentrations du compartiment
central de 50 % donc rend compte de l’accumulation
dans l’organisme et est indépendante de la durée
de perfusion pour des durée inférieures à 8 heures .
- Le REMIFENTANYL : 3.7
mn = peu d’accumulation
- Le SUNFENTANIL : 30
mn
- L’ALFENTANYL : 1
heure
- LE FENTANYL : 262 mn
= accumulation importante
DUREE
D’ACTION
- La durée
d’action n’est pas la demi vie
d’élimination mais dépend du volume de
distribution et de redistribution ceci pour des doses
faibles .
- Pour des doses plus
conséquentes , le stockage dans les zones musculaires
est saturé , seul l’élimination fera alors
décroître le taux de concentration de la molécule , la
durée d’action sera plus importante dans ce cas de
figure.
LA
LIPOSOLUBILITE
- Va conditionner la
bonne diffusion des produits.
- Plus la
liposolubilité est importante et plus la diffusion sera
bonne , la durée d’action sera augmentée mais le
pic d’action sera plus tardif .
- Exemple
Alfentanil : VD plus petit que sufentanil donc demi
vie d’élimination plus courte , phase de
redistribution plus courte , avec une moins grande
accumulation dans les muscles , la possibilité
d’élimination dépendra de la Clearance plasmatique
.
- Cette clearance sera
perturbée en cas de :
- Insuffisance
hépatique
- Chirurgie
abdominale
- Diminution du
débit sanguin et particulièrement hépatique
(Bêta bloquants)
- Facteurs
modifiant la fraction libre
- Inhibition
enzymatique (cytochrome P450)
- Dans 10 % des
cas il peut exister un polymorphisme de synthèse
des enzymes hépatiques .
SURVEILLANCE
D’UN TRAITEMENT MORPHINIQUE
- Efficacité :
L’EVA
- La dépression de la
ventilation (les effets sédatifs précède la
dépression )
- La somnolence qui
précède la dépression respiratoire
- Les Prurits
- Les nausées
- La rétention
vésicale
LE
TERRAIN DE LA DEPRESSION RESPIRATOIRE
- sujets âgés
- Asa 3-4
- L’Obésité avec
les apnées du sommeil
- Les associations avec
d’autres morphinique ou sédatifs
- La voie péridurale
- Surveillance en
SSPI puis toute les 4 heures en salle , de la
sédation , du rytme de la respiration, de
l’efficacité de l’analgésie , de la survenue
de diverses complications : le globe , le prurit ,
les nausées...
POSOLOGIE
COMMUNE DES MORPHINIQUES MAJEURS
| |
Fentanyl |
Sufentanil |
Alfentanil |
| Induction doses |
2 à 5 µg/kg |
0.2 à 0.5 µg/kg |
20 à 50 µg/kg |
| SAP entretien |
dose d’induction horaire |
dose d’induction horaire(
0.2-0.5µg/kg) |
Rare en SAP bolus 15 à 30 mn 1/3 de
la dose d’induction |
| Pic d’action |
2 mn |
3 mn |
1 mn |
| Durée d’action bolus |
30 mn |
30 mn |
10 à 15 mn |
INTERACTIONS
MEDICAMENTEUSES
- Effets dépresseurs
potentialisés par :
- l’alcool
- les sédatifs
- anti
histaminique
- IMAO
- antidépresseurs
tricycliques
- les alpha 2
agonistes

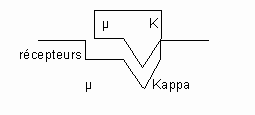 Les deux récepteurs sont activés.
Les deux récepteurs sont activés.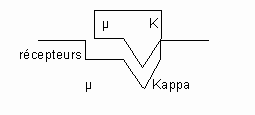 Les deux récepteurs sont activés.
Les deux récepteurs sont activés.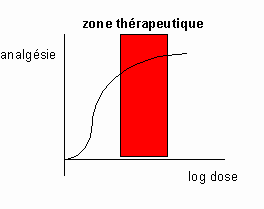 L’analgésie est illimitée
avec la hausse des doses. Agoniste pur : activités
intrinsèques de 1
L’analgésie est illimitée
avec la hausse des doses. Agoniste pur : activités
intrinsèques de 1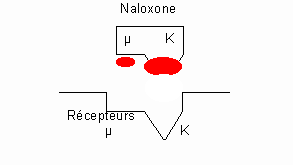 Pas d’activation des récepteurs
Pas d’activation des récepteurs 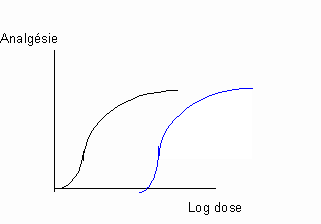 Déplacement de la courbe dose réponse
vers la droite grace à la présence de l’antagoniste qui
occupe les récepteurs sans activité intrinsèque.
Déplacement de la courbe dose réponse
vers la droite grace à la présence de l’antagoniste qui
occupe les récepteurs sans activité intrinsèque.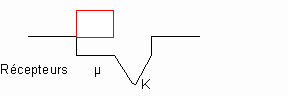 Activation partielle du récepteur µ.
Activation partielle du récepteur µ. 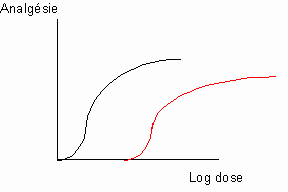 L’Agoniste partiel qui est aussi
antagoniste par son blocage du récepteur empêchant
l’agoniste pur de s’y fixer , l’agoniste partiel
déplace la courbe dose réponse vers la droite , d’autre
part , il est à noter l’existence d’un plateau
limitant l’activité maximale , de part la valeur faible
intrinsèque de son action pharmacocinétique et de son activité
antagoniste. (il ne sert à rien d’augmenter les doses).
L’Agoniste partiel qui est aussi
antagoniste par son blocage du récepteur empêchant
l’agoniste pur de s’y fixer , l’agoniste partiel
déplace la courbe dose réponse vers la droite , d’autre
part , il est à noter l’existence d’un plateau
limitant l’activité maximale , de part la valeur faible
intrinsèque de son action pharmacocinétique et de son activité
antagoniste. (il ne sert à rien d’augmenter les doses).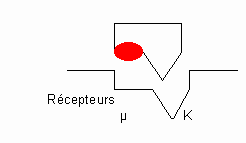 = antagonise µ - agoniste K.
Activation des récepteurs K, d’où activation partielle.
Occupation de µ : sans action.
= antagonise µ - agoniste K.
Activation des récepteurs K, d’où activation partielle.
Occupation de µ : sans action.